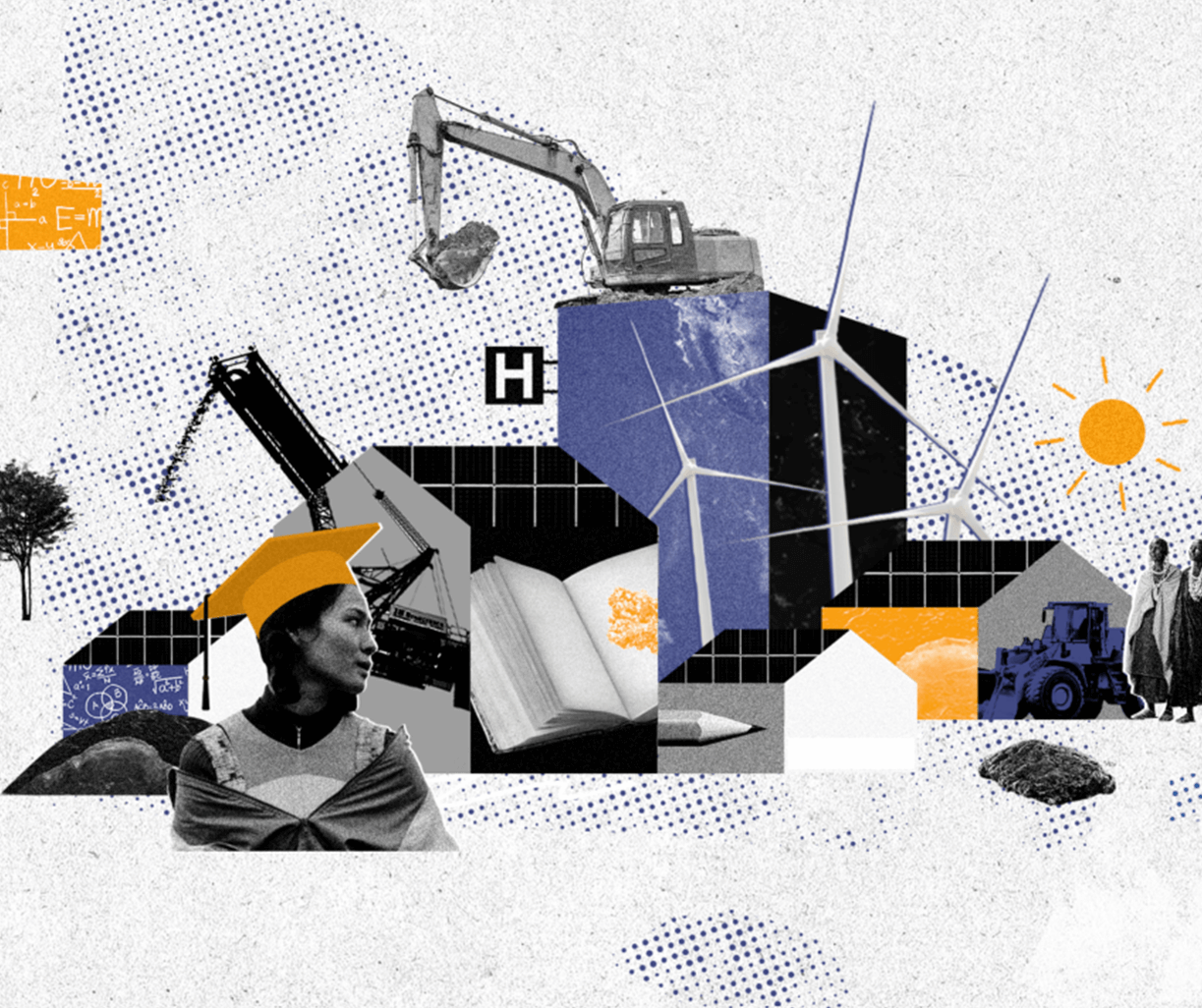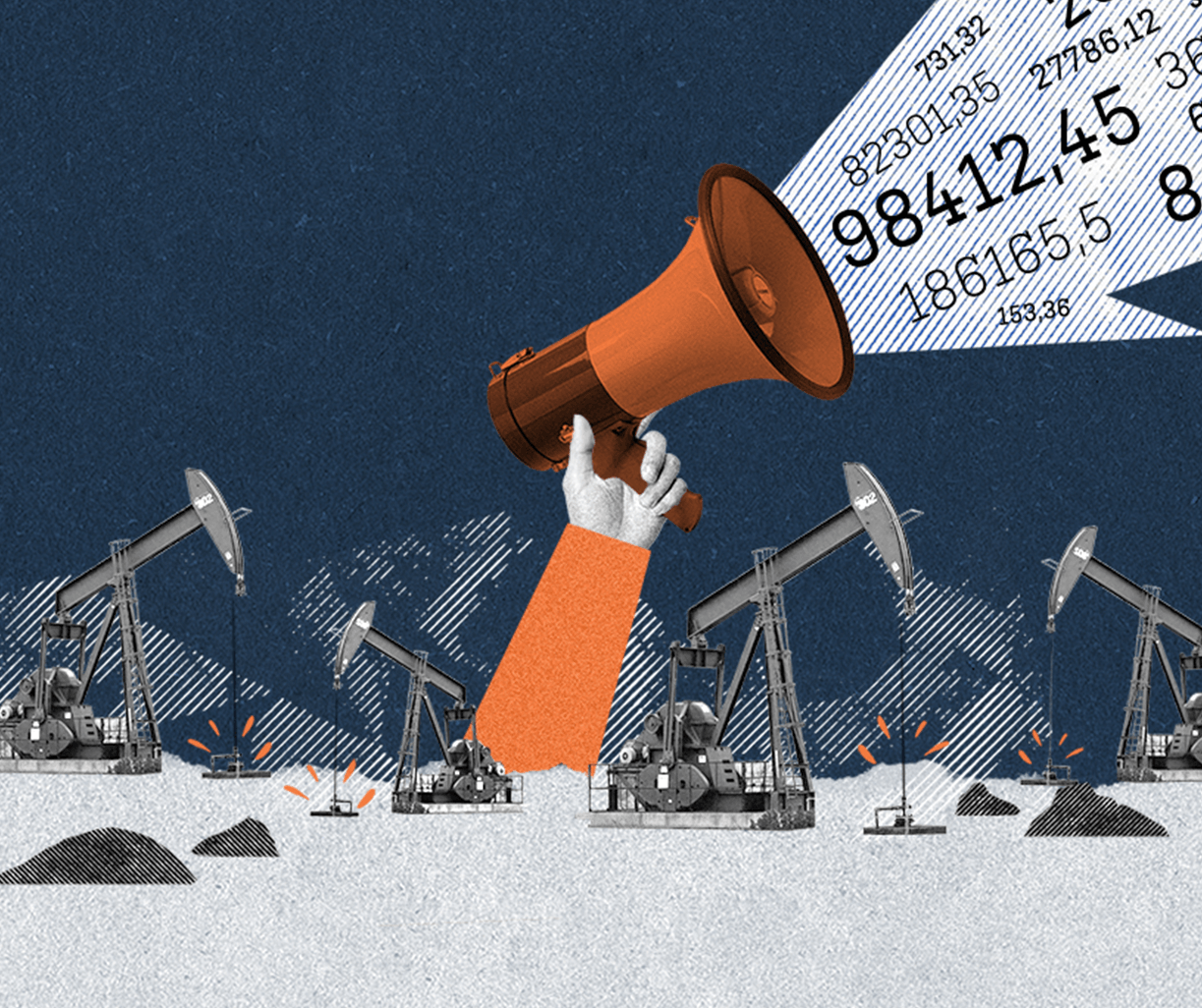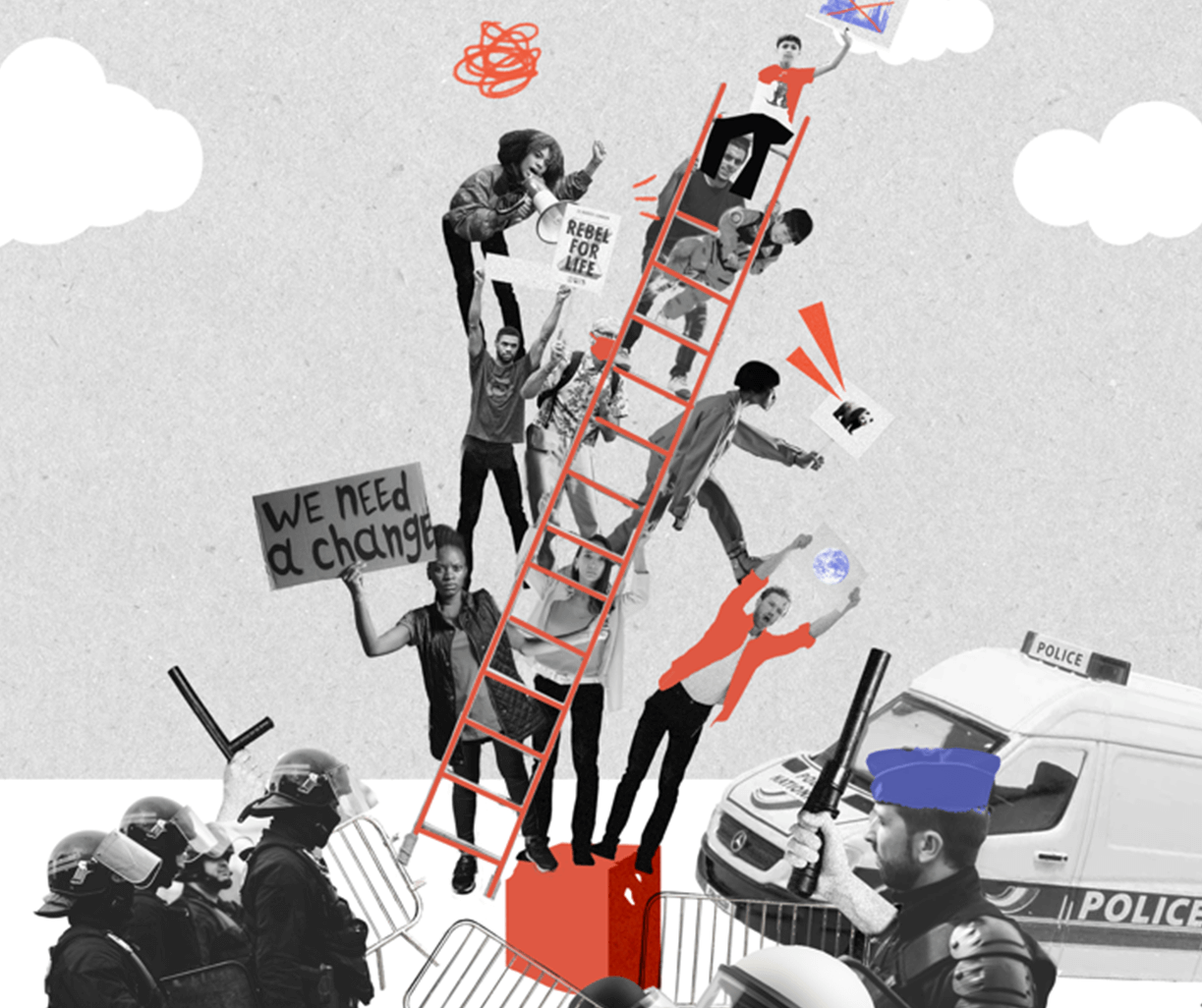Ce blog fait partie d’une série mandatée par le sous-comité stratégique de PCQVP (composé de membres du Conseil mondial, du Conseil d’administration et du Comité de pilotage pour l’Afrique de PCQVP). Les propositions et les positions de chacun·e des auteur·e invité·e n’ont pas été approuvées par PCQVP : PCQVP les a invité·e·s à les partager en vue de stimuler une réflexion collective en préparation de notre prochaine stratégie mondiale.
Avec une température moyenne mondiale supérieure de 1,45 °C à la moyenne constatée entre 1850 et 1900, 2023 a été l’année la plus chaude enregistrée à ce jour. Or ce chiffre se rapproche beaucoup de la limite fixée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015.
Les conséquences d’un réchauffement mondial sont désastreuses : la température des océans grimpe, la banquise arctique rétrécit et s’amincit, les glaciers disparaissent, tandis que les canicules, inondations, sécheresses, feux de forêt et cyclones deviennent plus fréquents et plus intenses.
Dans tous les cas, ceux qui contribuent le plus au problème sont les pays les plus riches et les couches de populations les plus aisées – avec une consommation d’énergie par personne plus élevée et les émissions de gaz à effet de serre accrues qui en découlent. À l’inverse, les pays et les populations les plus pauvres y contribuent le moins, tout en en subissant les conséquences les plus graves.
Face à cette situation, une discussion a émergé autour de la notion de transition énergétique « juste » en faveur des sources d’énergie à faibles émissions de carbone : cette transition serait une source d’emplois et de revenus pour les personnes qui dépendent actuellement de l’exploitation des combustibles fossiles pour assurer leur subsistance. En outre, elle assurerait l’accès à l’énergie pour tou·te·s et apporterait une aide financière aux pays moins développés et dépendants des combustibles fossiles, qui seront obligés de ne pas exploiter leurs ressources pour faire cesser le réchauffement climatique.
La bonne nouvelle est que la transition énergétique progresse, avec une baisse des investissements dans les combustibles fossiles et une hausse des investissements dans la production et la consommation d’énergies renouvelables non conventionnelles.
La mauvaise nouvelle est que la transition n’avance pas aussi vite qu’il le faudrait et qu’elle est loin d’être juste.
Une transition énergétique portée par les entreprises
Nous vivons de facto une transition énergétique menée par les entreprises qui voient dans la transition une nouvelle possibilité d’accumulation de capital. Les décisions relatives à l’investissement dans la production et la distribution de nouvelles énergies renouvelables dépendent de la rentabilité qu’elles offrent aux investisseur·se·s et des rentes qu’elles peuvent générer pour les gouvernements – et non des moyens de subsistance qu’elles peuvent offrir ou améliorer pour les populations des pays moins développés, ou même des pays développés.
En outre, les pays les plus riches exploitent toujours leurs ressources en combustibles fossiles et ne contribuent pas autant qu’ils le devraient aux mesures d’atténuation et d’adaptation dans les pays du Sud. Et si la contribution des pays les plus riches n’est pas suffisante, celle des couches les plus riches de la population est inexistante, puisqu’il n’y a pas d’accords mondiaux pour taxer les contributeurs les plus importants aux émissions de carbone, tant à l’échelle des entreprises que des individus.
Dans ce scénario, l’urgence et la justice sont des considérations secondaires par rapport au profit et au maintien des niveaux élevés, mais insoutenables, de consommation des pays du Nord.
Ce qu’il faut retenir, c’est que le climat mondial, la crise environnementale, les questions de souveraineté énergétique et de justice sociale ne figurent pas dans les priorités des décisionnaires de la transition énergétique.
Et les populations qui souffrent des conséquences du réchauffement climatique n’ont pas leur place à la table où les décisions sont prises. Or comme on le sait, si vous n’êtes pas autour de la table, c’est que vous êtes probablement au menu.
Remettre en cause les structures du pouvoir
Pour parvenir à une transition juste et opportune, nous devons remettre en question la place des entreprises dans la transition en cours. Nous devons contester les modalités décisionnelles actuelles et les structures du pouvoir qui les sous-tendent.
Ce qu’il faut, c’est une transformation démocratique et équitable du système énergétique.
Toute la difficulté consiste à créer les conditions propices à cette transformation. Et la clé est une société civile mobilisée et impliquée, capable de placer l’urgence et la justice au cœur du processus décisionnel concernant le rythme et la nature même de la transition énergétique.
En sommes-nous à ce stade ? Non. Mais nous devons et pouvons commencer à nous orienter dans cette direction.
Nous devons insister pour faire pression sur les gouvernements et les entreprises à l’échelle mondiale lors des COP et d’autres réunions similaires, afin de conclure des accords d’atténuation et de financement plus ambitieux et contraignants.
Nous devons également exercer une pression à l’échelle nationale pour nous assurer que les engagements et les politiques en matière d’atténuation et d’adaptation sont à la hauteur du défi.
Trois défis critiques
Plus important encore, nous devons rassembler les acteur·rice·s sociaux·ales dans les territoires riches en ressources pour faire face à trois défis critiques : les moyens à déployer pour assurer une élimination progressive, équitable et rapide du charbon, du pétrole et du gaz ; la question de l’opportunité et des modalités de l’exploitation des minerais de transition ; les méthodes de production et distribution des énergies renouvelables non conventionnelles.
Sur cette base, nous pouvons élaborer des stratégies nationales ascendantes qui bénéficient d’un réel soutien social pour assurer la transition de la matrice énergétique. Ces stratégies intégreraient à l’échelle locale les acteur·rice·s les plus touché·e·s par le réchauffement climatique dans les processus décisionnels, ceux et celles qui sont actuellement laissé·e·s pour compte.
Ce faisant, nous transformerons efficacement le système énergétique, ses modalités de prise de décision et ses relations de pouvoir.
PCQVP a un potentiel exceptionnel pour contribuer à une transition juste de la matrice énergétique et à une transformation démocratique et équitable du système énergétique. Et l’organisation a commencé à mettre en avant cet atout dans sa position sur la transition énergétique approuvée en 2021.
Sa diversité interne – expression de sa portée mondiale – pourrait être vue comme un obstacle à la création d’une réponse cohérente à la crise climatique, alors que c’est en réalité un atout.
En effet, en nous appuyant sur cette diversité, nous pouvons construire une réponse mondiale plus forte à la crise climatique, une réponse ancrée dans les besoins du plus grand nombre, et non d’une petite élite.